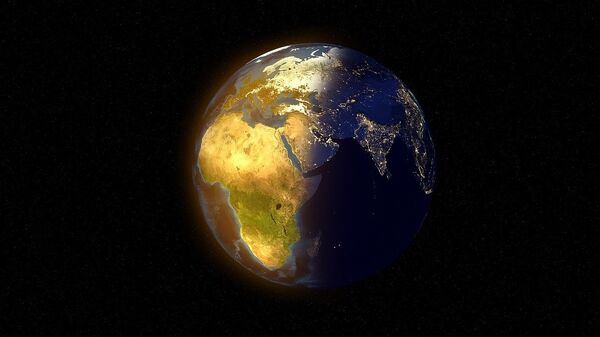En dépit du contre-exemple soudanais d’avril 2019, il est aujourd’hui possible d’affirmer, statistiques à l’appui, que les coups d’État n’ont plus le vent en poupe en Afrique. Les deux premières décennies de ce siècle auront connu, tout au plus, une quinzaine de putschs réussis, soit le nombre de coups d’État accomplis pendant la seule décennie 1990. La tendance dessine bien une courbe décroissante: des militaires ou des responsables civils africains ont accédé une vingtaine de fois au pouvoir via des coups d’État durant les années 1980, contre une demi-cinquantaine de fois durant les années 1970.
La régression des coups d’État coïncide sans doute avec une acclimatation sur le continent de la culture démocratique, particulièrement à travers deux instruments. Celui du Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine, dont les sanctions aux changements anticonstitutionnels de gouvernements sont systématiques. Celui, également, d’une levée de boucliers citoyenne, avec une implication et des moyens d’action renforcés de la société civile africaine.
Pour Leslie Varenne, présidente de l’Institut de veille et d’étude des relations internationales et stratégiques (IVERIS), les crises postélectorales prenant naissance à la suite de scrutins torpillés «n’ont jamais fait changer la situation».
«Si on regarde toutes les élections contestées sur le continent africain, on s’aperçoit que les crises post– électorales n’ont jamais rien fait changer à la situation. Au contraire, elles ont amené un appauvrissement de la population, parce qu’il y a une situation d’insécurité qui fait que l’économie marche moins bien. Ces crises sont réprimées, et donc ceux qui continuent à contester vont en prison ou subissent des répressions sévères.
Ces crises amènent encore plus de corruption, puisqu’il s’agit pour ceux qui sont au pouvoir de rallier à leur cause, par tous les moyens, la répression ou la corruption, les opposants qui contestent l’élection. Finalement, les deux seules crises électorales qui ont réussi à sauver la donne et à remplacer le pouvoir en place, le Président sortant mal élu par un opposant, c’est en Côte d’Ivoire en 2011 et en Gambie, mais ce sont des crises électorales qui ont été supportées par des instruments militaires (occidentaux ou régionaux). Autrement, force est de constater que ça ne marche pas.», constate Leslie Varenne pour Sputnik.
Joseph Kabila, à la tête de la République démocratique du Congo (RDC), ne s’y était essayé qu’indirectement fin 2015. À l’époque, le Burundi brûlait à ses frontières orientales, suite à une réélection controversée du Président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Kabila tente alors une diversion. Au lieu de retoucher le texte constitutionnel, fixant à deux le nombre des mandats présidentiels, il descend d’un échelon dans la hiérarchie des normes de droit de Kelsen. Une loi a été proposée au Parlement, qui subordonne l’organisation de la présidentielle à la tenue d’un recensement de la population, pouvant techniquement prendre, selon des experts, jusqu’à quelques années. La manœuvre échoue devant la forte détermination de la société civile, qui a en l’occurrence bénéficié de l’expertise de son homologue sénégalaise. Si bien qu’il ne restait à Kabila que la troisième voie.
Se soumettre, se démettre ou… compromettre?
En 1877, les événements de la crise institutionnelle de la troisième République française mettaient le Président de la République, le monarchiste Patrice de Mac-Mahon, devant un choix difficile, résumé par la célèbre formule de Léon Gambetta: «se soumettre ou se démettre!» Aujourd’hui, entre des Présidents se soumettant aux diktats des putschistes, d’autres se démettant dans le cadre d’une alternance, l’Afrique semble expérimenter «une troisième voie». Il s’agit, selon l’universitaire franco-congolais Lucien Pambou, de «la tentation de l’alternance, mais à l’intérieur d’un même clan politique ou d’un réseau politique», quitte à ce que les protagonistes ne soient pas d’une même couleur politique. L’objectif est «pour le clan qui est aux affaires, de ne pas perdre ses intérêts». Dans cette optique, il choisira d’installer au pouvoir, et au terme de négociations, ceux qui seront les mieux à même de protéger les intérêts du clan, quitte à exclure les autres, que ce soit en amont ou en aval du processus électoral.
«C’est un nouveau modèle auquel l’Occident n’est pas tellement habitué. On comprend très bien avec les déclarations de M. Le Drian, qu’il avait comme favori M. Fayulu. La France se trouve ainsi démunie, avec cette négociation qui s’est faite quasiment sur son dos à l’intérieur du pays, entre Kabila et Tshisekedi», poursuit le professeur de sciences politiques Lucien Pambou.
En privilégiant Félix Tshisekedi au ticket Katumbi-Bemba, du nom des puissants soutiens de Fayulu, le Président de la RDC, Joseph Kabila, a ainsi choisi pour sa succession les moins irréductibles de ses opposants. Ce qui lui garantit de ne pas être inquiété pour ses «dérapages», supposément commis depuis 2006, mais aussi d’organiser une forme de partage du pouvoir.
«La (fausse) négociation démocratique se met en place, aussi, parce que des oppositions, qui devraient asseoir un modèle démocratique, ne sont pas de vraies oppositions. Elles sont dans un autre jeu […] elles veulent préserver leurs privilèges et acceptent, peu ou prou, ce que dit le pouvoir en place. Ceux qui ont cru, au Congo Brazzaville, que Guy Kolélas et Pascal Mabiala étaient de vrais opposants en sont pour leurs frais.»
Définie par Lucien Pambou comme «modèle à mi-chemin entre celui, brutal, des coups d’État, et celui de la véritable alternance», cette forme ne serait pas à rejeter complètement, recommande l’expert français. Tout dépendra de celui qui arrivera aux affaires et de sa capacité à répondre aux vrais problèmes que rencontre le pays. Pour la RDC, le défi de Félix Tshisekedi consiste à «construire un modèle mettant le Congo sur les rails du développement économique, tout en tenant compte de l’environnement national et international».
«L’Afrique est en train de creuser un sillon un peu spécial et difficile à arpenter entre de fausses alternances démocratiques et la volonté de faire advenir ou émerger de vrais régimes politiques valables pour l’alternance», conclut Lucien Pambou.